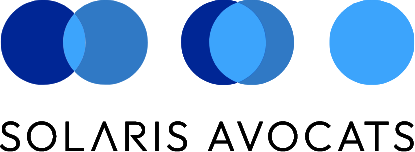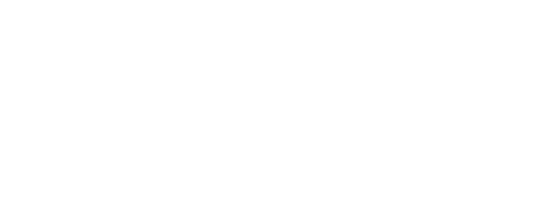La question de savoir si la cour d’appel doit nécessairement préciser, dans le dispositif de sa décision, qu’elle réforme, annule ou confirme le jugement attaqué, suscite depuis peu de vifs débats. Dans un arrêt récent, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que l’article 542 du code de procédure civile ne crée pas une telle obligation, suscitant incompréhensions et critiques quant au rôle exact du juge d’appel.
Contexte et rappel du cadre légal
La procédure d’appel, en droit français, est traditionnellement régie par une logique duale. D’un côté, l’article 542 du code de procédure civile stipule que l’appel tend, « par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation ». De l’autre côté, les exigences procédurales modernes, renforcées par une jurisprudence abondante depuis 2020, imposent à l’appelant de solliciter expressément, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement. Sans cet effort formel, les avocats peuvent se voir infliger des sanctions lourdes : confirmation du jugement contesté ou, pire encore, caducité de la déclaration d’appel.
Cette évolution a pour principal objectif de clarifier la fonction du juge d’appel, censé être « juge du jugement » avant d’être « juge du litige ». Dans l’esprit du législateur et de la jurisprudence, il s’agit d’éviter que l’instance d’appel ne reproduise une deuxième première instance en tout point, comme si le premier jugement n’avait jamais existé. L’obligation pour les avocats de solliciter formellement la réformation ou l’annulation vise à affirmer que la cour d’appel doit commencer par se prononcer sur le jugement lui-même. Seulement après cette prise de position, elle se prononce au fond si nécessaire.
Dans ce contexte, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rendu un arrêt qui surprend de nombreux praticiens. Elle y affirme que l’article 542 du code de procédure civile, parce qu’il se borne à définir « l’objet de l’appel », ne fait pas obligation au juge d’appel de préciser, dans le dispositif de son arrêt, s’il réforme, annule ou confirme le jugement entrepris. Pour beaucoup, cette solution paraît en porte-à-faux avec l’exigence inverse imposée aux avocats d’indiquer, dès leurs premières conclusions, leur volonté d’infirmation ou d’annulation du jugement de première instance.
Un formalisme renforcé pour les avocats
Depuis 2020, la Cour de cassation ne cesse d’accentuer la rigueur formelle qui pèse sur l’appelant. Les textes relatifs à la procédure d’appel ont été interprétés de manière stricte, notamment par la deuxième chambre civile, qui a estimé que l’appelant devait introduire dans le dispositif de ses conclusions une demande de réformation ou d’annulation du jugement, sous peine de sanction. Par la suite, cette jurisprudence a été étendue à l’appel incident, puis l’absence de prétention expresse sur le jugement a conduit la Haute juridiction à prononcer des confirmations d’office ou des caducités de déclaration d’appel.
Les avocats se sont donc adaptés, non sans difficulté. Cette obligation de soumettre au juge une demande d’infirmation ou d’annulation est devenue un passage obligé pour sécuriser l’appel. Elle alourdit parfois la procédure, car beaucoup de professionnels avaient jusqu’alors pour habitude de se concentrer sur le fond du litige, partant du principe que les seules conclusions matérielles permettaient déjà de comprendre quelle partie contestait le jugement et sur quels points.
Le même raisonnement pouvait s’appliquer à l’intimé, qui a, certes, moins d’obligations textuelles en la matière mais qui, par prudence, conclut souvent à la confirmation du jugement pour se mettre à l’abri de toute contestation procédurale. Résultat : les procédures d’appel sont devenues un terrain miné, où l’omission d’une formule sacramentelle peut conduire à des conséquences radicales. Cette exigence formelle avait trouvé un point d’ancrage dans l’article 542 du code de procédure civile, interprété comme la pierre angulaire imposant non seulement l’existence d’une critique, mais aussi la formulation explicite d’une prétention sur le jugement.
La position controversée de la Cour de cassation
Le revirement – ou du moins la solution adoptée récemment par la chambre commerciale – crée la surprise. Dans l’affaire ayant mené à l’arrêt commenté, la cour d’appel avait directement statué sur les prétentions au fond, sans se prononcer explicitement sur le sort du jugement de première instance. L’appelant se plaignait donc du silence de la juridiction du second degré, silence d’autant plus étonnant que le premier juge avait déjà statué, et que l’appelant avait, lui, demandé l’infirmation de ce jugement. Selon le pourvoi, l’arrêt d’appel méconnaissait l’article 542 du code de procédure civile, qui devait logiquement obliger la cour d’appel à réformer, annuler ou confirmer le jugement entrepris.
La chambre commerciale répond en substance que l’article 542 définit simplement l’objet de l’appel, sans toutefois imposer à la cour d’appel de préciser dans le dispositif la réforme, l’annulation ou la confirmation du jugement attaqué. Pour certains auteurs, c’est là une forme de « schizophrénie » procédurale, car si les avocats sont contraints de formuler des prétentions explicites sur le jugement, il semblerait logique que le juge, en retour, tranche cette question. De plus, le risque de confusion est réel : si la cour ne confirme ni n’infirme, le jugement de première instance demeure-t-il applicable en parallèle de la nouvelle décision ? Ne crée-t-on pas ainsi un cumul de décisions, au détriment de la sécurité juridique ?
Plusieurs griefs sont dès lors adressés à cette jurisprudence : un déni de cohérence, puisqu’on impose aux parties ce que le juge s’autorise à négliger ; un déni de justice, puisque le principe dispositif voudrait que tout ce qui est demandé par les parties – ici, la réformation ou la confirmation – reçoive une réponse, à peine d’omission de statuer ; et un déni d’office, dans la mesure où la fonction même du juge d’appel est de juger le jugement avant de statuer sur le litige.
Conséquences pratiques et perspectives
La première conséquence de cet arrêt, c’est qu’il rend la pratique incertaine. Dans l’immense majorité des cours d’appel, les magistrats ont l’habitude de commencer leur dispositif par une phrase du type « La cour, statuant publiquement, réforme (ou confirme) le jugement rendu par le tribunal… ». On pensait que cette formulation n’était pas seulement un usage poli, mais une véritable obligation procédurale. À en croire la solution nouvelle de la chambre commerciale, cette étape solennelle, censée répondre à l’exigence d’une saisine de la cour en réformation ou annulation, ne serait pas juridiquement obligatoire. Beaucoup craignent qu’un tel relâchement ne déstabilise l’architecture même de la procédure d’appel, fondée sur une hiérarchisation des instances : on fait appel pour faire juger le jugement, et seulement ensuite le litige.
Dans la pratique, il est plus que probable que la grande majorité des juridictions d’appel continueront de réformer, annuler ou confirmer de façon explicite, ne serait-ce que pour des raisons de clarté. En revanche, pour quelques décisions ponctuelles, la solution de la chambre commerciale pourrait inciter certaines cours à s’en tenir au fond du litige, au risque de créer des situations ambiguës. Les avocats, eux, continueront à multiplier les précautions rédactionnelles dans leurs conclusions : il serait périlleux de se reposer sur une éventuelle simplification implicite, car la jurisprudence antérieure demeure stricte dès lors qu’il s’agit de sanctionner l’absence de prétention expresse sur le jugement.
À plus long terme, on peut espérer un revirement ou, du moins, une mise au point de la Cour de cassation. La cohérence de la procédure civile exigerait que si l’appelant est obligé de demander l’infirmation ou l’annulation d’un jugement, la juridiction saisie réponde à cette demande de manière formelle. Le mouvement global de réformes successives (décrets, circulaires, jurisprudences) tend vers une formalisation croissante de l’appel comme voie de réformation plutôt que de simple ré-examen de la totalité du litige. Il paraît dès lors contradictoire de dispenser la juridiction du second degré de toute mention claire quant au sort du jugement attaqué, alors même qu’elle doit, dans l’absolu, organiser la sécurité juridique des justiciables et mettre fin au conflit.
Cet arrêt de la chambre commerciale suscite de nombreuses interrogations dans le monde des avocats et des magistrats, et plus largement parmi tous les praticiens du contentieux civil. Loin d’être anecdotique, il interroge la cohérence même de l’office du juge d’appel. S’il est logique d’imposer aux professionnels du droit un formalisme précis pour saisir la cour, ne serait-il pas tout aussi cohérent d’exiger de celle-ci qu’elle statue formellement sur la confirmation, la réformation ou l’annulation du jugement attaqué ? La question reste ouverte. En l’état, une zone d’ombre demeure, et il ne fait guère de doute que la Cour de cassation, confrontée à d’autres pourvois, sera amenée, tôt ou tard, à clarifier à nouveau la portée de l’article 542 du code de procédure civile. D’ici là, l’usage prudent et traditionnel de statuer explicitement sur le sort du jugement restera sans nul doute la règle de facto dans la plupart des juridictions d’appel françaises.